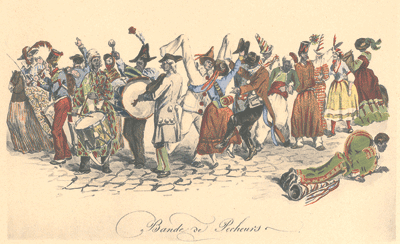

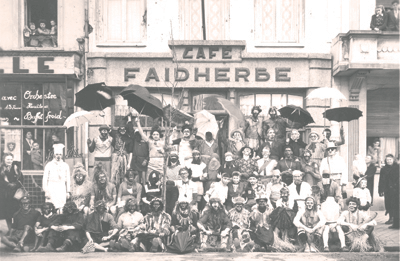
"A Dunkerque, le
Carnaval a une histoire vieille de
plusieurs siècles. Il tire son origine dans les pratiques festives et
religieuses des jours gras précédant le début du Carême. Une ordonnance
du Magistrat du 16 janvier 1676 réglemente déjà la sortie des masques.
L’originalité du Carnaval dunkerquois tient du fait qu’aux XVIIème et
XVIII siècles les armateurs offrent une " foye " aux pêcheurs à
Islande, cela signifie qu’en plus d’une avance sur salaire les marins
bénéficient également d’un festin, ou d’une fête, en partie payée par
l’armateur. Cette fête donnée avant le départ pour six mois de mer,
avec l’isolement, la crainte du naufrage et les conditions de vie
précaire que cela comporte, est à l’origine de la Visshersbende (bande
des pêcheurs en flamand), cependant elle est encore distincte du
Carnaval des jours gras.
Le flamand est à cette époque la langue parlée à
Dunkerque et les chansons entonnées par les marins sont alors toutes en
flamand. Un jour, le départ pour l’Islande et la foye donnée en cette
occasion coïncident avec les jours gras qui annoncent le début du
Carême. Les marins se parent alors de masques et de déguisement avant
de s’adonner à leurs réjouissances favorites. La Visshersbende, au sens
carnavalesque du terme, est née. Sous la révolution une délibération de
l’autorité municipale interdit toute manifestation carnavalesque par
crainte du trouble.
Au XIXème siècle, l’évolution du Carnaval suit de
prés l’essor et les vicissitudes de la pêche à la morue. Les
dramatiques naufrages des morutiers suscitent des élans de générosité
qui sont à l’origine de l’activité des sociétés philanthropiques et
carnavalesques (organisation de bals de bienfaisance, quêtes sur le
parcours de la bande au profit des veuves et orphelins de marins péris
en mer). La bande des pêcheurs sort le lundi gras et le carnaval
s’achève le soir du mercredi des cendres marquant le début du
Carême.L’hiver 1847, particulièrement rigoureux, contraint les
Dunkerquois à reporter pour cause d’intempéries les manifestations
carnavalesques au premier dimanche de Carême. C’est la première fois
que le Carnaval se déroule après les jours gras.
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, l’apogée de
la pêche à la morue fournie des ressources importantes aux Dunkerquois,
ce qui est de bonne augure pour la vitalité du Carnaval. Le 10 février
1861, le cortège sort de l’hôtel des pompiers en Basse-Ville et arpente
la ville cinq heures durant.
Peu à peu le déclin de la pêche à
la morue se fait sentir à Dunkerque ; la Visshersbande perd également
de sa vigueur. En 1896, le journal le Nord Maritime prédit même la fin
de la bande des pêcheurs ; les jours de Carnaval il y a plus de
touristes que des masques dans la ville. En 1900, si les bals
conservent leur succès, les bandes périclitent, ce qui n’est pas sans
conséquences sur le commerce local.
En 1906, la municipalité animée par Alfred Dumont,
le maire de Dunkerque également connu sous le diminutif de " Fret’ch ",
met en place une dynamique pour relancer le Carnaval de rue. En 1914, à
la veille du premier conflit mondial, le tambour major Cô-gnac emmène
une bande aux rangs bien fournis à travers la cité corsaire. Supprimé
en 1915 pour cause de guerre, rétabli en 1920, le Carnaval est
également un indicateur de la santé économique de la vile. Les
mouvements de grève survenant lors du Carnaval influant fortement sur
la participation de la population comme lors de grèves des ouvriers du
textile de février 1924. Les bals connaissent une grande vogue au début
du XXèmes siècle et s’étalent déjà sur une période allant du 29 janvier
au 6 mars environ. En 1924, les cuivres rejoignent les fifres et les
tambours au sein de la musique. En 1926 a lieu la première bande de la
Citadelle, quartier marin tout indiqué pour recevoir la bande des
pêcheurs.
Dans les années trente, la crise économique bride
les Dunkerquois dans leur frénésie carnavalesque ; toutefois les plus
acharnés d’entre eux n’hésitent pas à placer leurs objets de valeur au
Mont de Piété pour bénéficier d’un emprunt afin de faire face aux
dépenses carnavalesques. A partir de 1932, la bande des pêcheurs sort
le mardi gras à Dunkerque, comme à Rosendaël ou à Saint-Pol-sur-mer.
C’est le cas en 1939, date de la dernière bande avant une période
d’abstinence de sept ans, seconde Guerre Mondiale oblige.
Le Carnaval redémarre en 1946 et entraîne la Visshersbande dans les ruines de Dunkerque. Le Carnaval a cependant des difficultés à se développer dans les années cinquante, les bals de Carnaval remportent une plus grande adhésion que les bandes. A la fin du XXème siècle, le Carnaval connaît une large influence et n’est pas prêt de mourir. "

L'exploit le plus célèbre du corsaire dunkerquois date de 1694 quand il s'empare aux dépens des hollandais, au large de Texel, d'un énorme convoi de 130 navires chargés de blé. Cette prise, effectuée en période de disette, fait de Jean-Bart un héros national et lui vaut ses lettres de noblesse. Chef d'escadre en avril 1697, il commande la Marine à Dunkerque où il meurt le 27 avril 1702. La France a depuis rendu hommage à Jean Bart en donnant son nom à 9 batiment de la marine, c'est un héros pour tout les dunkerquois et il est entéré à St Elois.

PRÉSERVER LA TRADITION
Quand
amusement rime avec enseignement, le carnaval envahit aussi l’espace
scolaire. Désormais, la plupart des écoles recentrent leurs projets
pédagogiques sur les origines d’une tradition vieille de trois siècles,
sur les chansons, et organisent leur propre défilé intra-muros, à
l’exception des écoles du centreville qui préparent une véritable bande
miniature.
L’école tente ainsi d’inculquer le bon carnaval aux enfants aidée dans
cette tâche par la municipalité, l’ABCD, des musiciens et des
indépendants. Ensemble, ils ont créé une charte intitulée "Carnavaleux
respectueux, carnavaleux heureux